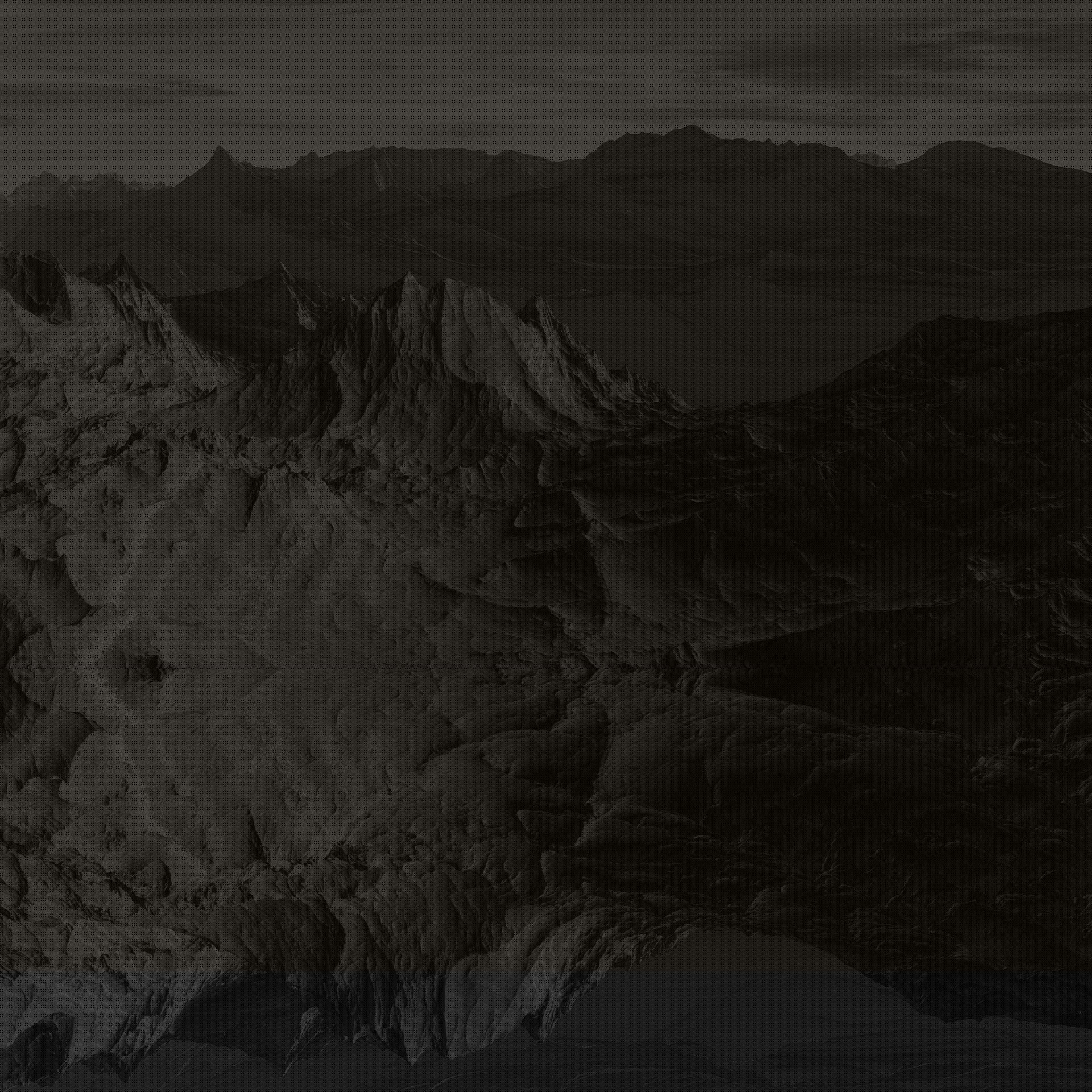
Géographie affective
Par Camille Caulet et Gulya Cakmak (février 2024)
La géographie affective est un concept repris par Inés Depetris Chauvin dans son ouvrage, Geografías afectivas. Desplazamientos, prácticas espaciales y formas de estar juntos en el cine de Argentina, Chile y Brasil (2002-2017) dans lequel elle évoque le “tournant culturel” dans le champ de la géographie et le “tournant spatial” (1) dans d’autres domaines de la connaissance ainsi que les nouvelles perspectives critiques concernées par la spatialité des formes discursives, les relations sociales, la politique et les pratiques de représentation (Soja, 1989). La géographie affective n’est pas, selon elle, qu’une simple métaphorisation de l’espace ou des considérations figuratives de la cartographie au cinéma (3) qui valorisent l’analyse des affects dans la perception de l’espace. Elle rend également compte de l’espace comme une construction émanant de la perception.
Depetris Chauvin tente également de dépasser la notion d’espace comme rhétorique qui scinderait la pratique théorique de la pratique sociale (3). La géographie affective permet alors de concevoir des spatialités affectives et un espace qui devient une “fonction de la vision” (2).
Selon elle,
El cine juega un papel crucial en la comprensión del lugar de un individuo o de una comunidad en el mundo pero, al mismo tiempo, una extensión generalizada y aparentemente contagiosa de metáforas de mapeo en los campos de estudio sociales y culturales complica el intento de establecer los par´metros conceptuales mediante los cuales las ideas de la cartografía o del imaginario geográfico en relación con el cine podrían ser entendidas productiva y críticamente.
[Le cinéma joue un rôle fondamental dans la compréhension du lieu auquel est rattaché dans le monde un individu, une communauté mais, dans le même temps, une extension généralisée et à priori contagieuse de métaphores autour de la cartographie dans les champs des études sociales et culturelles complique l’intention d’établir les paramètres conceptuels moyennant lesquels les idées de la cartographie ou de l’imaginaire géographique et leur rapport au cinéma pourraient être comprises à la fois de manière productive et critique.]
Depetris Chauvin présente la géographie affective comme un concept voyageur, dans les termes de Mieke Bal (2002), c’est à dire comme des “représentations abstraites d’un objet” qui se transforment en “instrument de l’intersubjectivité” (Bal 2002, p. 22). D’inspiration également Deleuzienne, sa conception des affects se distingue de celle des émotions en ce que les premiers seraient moins traversés que les seconds par la culture et le langage. La géographie affective devient une appréhension des spatialités affectives au service de la compréhension des rapports de domination sur le principe de l’attribution d’une matérialité haptique au cinéma permettant des analyses autres que sémiotiques de celui-ci (14).
En France, Pauline Guinard (2023) parle d’une géographie (é)mouvante pour rendre compte du dynamisme que peut donner la prise en compte des émotions dans la conception de la géographie
La géographie affective explore la manière dont les lieux influent sur nos émotions et expériences. Les films offrent des représentations visuelles révélant comment les environnements façonnent les sentiments. Elle s’étend naturellement au cinéma portant sur l’éducation dans une exploration sensorielle de l’environnement scolaire. Les écoles sont des lieux qui jouent un rôle important dans l’évolution sentimentale des élèves et étudiants. L’école est un endroit qui permet de créer des liens affectifs avec des camarades ou même encore des professeurs. L’atmosphère scolaire a une place importante dans le développement personnel par ailleurs.
Dans Les 400 coups (François Truffaut, 1959) la géographie affective nous permet de traverser les différentes étapes de la vie scolaire du personnage principal, Antoine Doinel, un adolescent en conflit avec son environnement familial et scolaire. L’école avec la salle de classe, les couloirs et la cour de récréation deviennent des lieux où Antoine se sent souvent incompris et aliéné, constamment en tension avec les figures d’autorité qui la traversent (son maître, le directeur, ses parents). Cet environnement l’emprisonne et renforce son désir d’évasion et d’indépendance. Les lieux de scolarisation s’opposent aux espaces de mobilité (urbaine en lien avec le cinéma à Paris, oui la mer vers laquelle il fugue) vers lesquels il cherche un refuge en faisant l’école buissonnière.
Cámara oscura (María Victoria Menis, 2008) est un film argentin dont les cadrages spécifiques de la géographie affective, notamment ceux qui renvoient à la domesticitité (portes, fenêtres, photographies) viennent rendre compte de l’enfermement de la condition de la femme et de son éloignement de l’éducation universitaire (Velez, 2014). Menis prête dans ce film une attention particulière aux affects que produit la vision du corps de la protagoniste autant que ceux qu’elle produit sur le photographe français qui vient fouler les parages pour commercialiser la “photo de famille”. Comme l’indique Depetris Chauvin, ce retour à l’affect produit par les corps dans une géographie donnée permet de revenir sur l’idée d’agency (13) mais aussi de valoriser une autre éducation au regard qui ne soit pas celle du regard pornographique tout en jouant avec les attentes qu'il porte (Velez, 2016).
Les K-drama avec un discours métafictionnel souvent inspiré de mangas, explorent également la géographie affective des lieux de scolarisation et leur succès est aujourd'hui légendaire car c'est un genre qui semble permettre de donner une multidimensionnalité aux lieux de scolarisation dans les récits cinématographiques, le lieu de la mise en abîme comme de la projection, c'est-à-dire de rencontre entre le passé et le futur imaginé depuis le entre de toutes les fièvres éducatives surtout telles qu'envisagées en Corée du Sud dans l'enseignement supérieur (Lee, 2006)
Références bibliographiques :
-
Depetris Chauvin, I. (2019). Geografías afectivas. Desplazamientos, prácticas espaciales y formas de estar juntos en el cine de Argentina, Chile y Brasil (2002- 2017). Pittsburgh, Estados Unidos: Latin American Research Commons. DOI: https://journals.openedition.org/alhim/5314. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/134613/CONICET_Digital_Nro.b7b6d6d9-e5d6-4fa5-ab65-de9f551c7904_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
-
Guinard, P. Pour une géographie émouvante : Lire les transformations urbaines par les émotions, dans le Grand Paris et à Lagos. Géographie. Université Grenoble–Alpes, 2023.https://hal.science/tel-04281112/
-
Soja, E. Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory https://mars1980.github.io/Space/resources/postmoderngeographies.pdf
-
Maria Gertrudis “Mieke Bal” Travelling concepts in the humanities. 2012 https://doubleoperative.files.wordpress.com/2009/12/bal-mieke-travelling-concepts-in-the-humanities1.pdf
-
Velez, I. (2014). « Tecnologías del género y de la información: el marco fotográfico en La cámara oscura (2008) de María Victoria Menis » in De cierta manera : cine y género en América latina, éd. Laurence H. Mullaly & Michèle Soriano, Paris, L’Harmattan, Collection « Sexualité et genre : fiction et réalité », pp. 123-147.
-
Velez, I. (2016) « El erotismo cinematográfico de la Cámara Oscura: revisiones estéticas e intericonicidad fílmica », Revista Interfaces 21/2016, 42 (janvier-juin 2016), pp.173-190. En ligne [https://159.90.210.125/node/61] ou à télécharger [https://159.90.210.125/sites/default/files/Estudios%2042/Irma%20Velez.pdf].
-
Lee, J.-K. (2006). Educational Fever and South Korean Higher Education. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8,1-14.
Filmographie :
-
Marjane Satrapi, Winshluss. (Producteurs). (2007). Persepolis [Film]. TF1 Vidéo.
-
Clint Eastwood. (Producteur). (2009). Gran Torino [Film]. Malpaso Productions. Warner Bros.
-
Peter Weir. (Producteur). (1989). Le cercle des poètes disparus [Film]. Silver Screen Partners IV. Touchstone Pictures.
